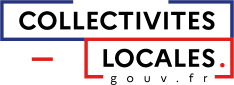/colo_struct_marc_publ/part_publ_2.html
Avant le 1er avril 2016, trois hypothèses permettaient de recourir au contrat de partenariat :
- l’urgence,
- la complexité du projet
- un bilan avantages/inconvénients favorable.
L’ordonnance du 23 juillet 2015, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité ont pour objet d’unifier et de consolider les différentes formules de partenariat public-privé existantes au profit d’une forme unique : le marché de partenariat.
Aujourd’hui, l’article L. 1112-1 du code de la commande publique définit le marché de partenariat comme : «un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.
Cette mission globale peut en outre comprendre :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. »
Pour mieux répondre à ses besoins, l’acheteur peut moduler les missions confiées au partenaire, en rendant facultatives les missions d’entretien, maintenance, gestion et exploitation. L’encadrement du recours à ce type de marchés est renforcé afin de sécuriser son utilisation.
L’évaluation préalable et les conditions de recours au marché de partenariat sont redéfinies puisque seule la condition du bilan favorable est maintenue afin de garantir l’utilisation de l’outil le mieux adapté au projet.
Conditions de recours au marché de partenariat
- Acheteurs autorisés (Articles L. 2211-1 à L. 2211-4)
Le marché de partenariat peut être conclu par tout acheteur, à l’exception de certains organismes, autres que l’État.
- Seuils (Article L. 2211-5, articles R. 2211-1 et R. 2211-2)
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru.
La valeur du marché de partenariat est évaluée en tenant compte de la rémunération du titulaire versée par l’acheteur, et, le cas échéant, des revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine et des éventuels concours publics.
- Bilan plus favorable (Article L. 2211-6, articles R. 2211-3 et R. 2211-4)
L’acheteur doit tenir compte de ses propres capacités à conduire l’opération pour établir le bilan, mais aussi des caractéristiques du projet lui-même. Le bilan doit permettre de comparer tous les montages contractuels envisageables et de démontrer la pertinence du choix contractuel retenu.
Le bilan fait l’objet d’une appréciation globale. Il tient compte de critères relatifs notamment au transfert de la maîtrise d’ouvrage, aux contours des missions confiées au titulaire, au partage des risques avec le titulaire du contrat et au coût du projet, sans qu’il soit nécessaire que chaque critère pris individuellement démontre un bilan favorable.
Pour en savoir plus, accédez à la fiche technique de la DAJ relative aux marchés de partenariat